Jeudis du genre
“Jeudis du genre” conferences are an opportunity to discuss recent publications and current topics. In particular, they provide an opportunity to present the Gender Institute’s Thesis Prize and to exchange with researchers benefiting from the Gender Chair or the Scientific residencies. The sessions are open to all.
2024 — 2025
Études aréales et études de genre : enjeux et défis
La journée d’étude, organisée par les GIS Institut du Genre avec les GIS Asie, Études africaines, Moyen-Orient et mondes musulmans, en collaboration avec le GIS Institut des Amériques, entend réfléchir aux croisements entre études de genre et études aréales. Ces recherches soulèvent des enjeux et défis spécifiques qui méritent examen, au vu de la vitalité des travaux et des questionnements explorés. Quelles sont les spécificités des études de genre en contexte aréal ? Que permet le décentrement par les terrains étrangers ? Quels approches, outils et méthodes impliquent-elles ? Quels en sont les enjeux épistémologiques ? Comment penser le rapport aux sources et aux terrains ? Quels renouvellements des objets de recherche ces perspectives croisées favorisent-elles ? La journée, qui ouvre une réflexion amenée à se prolonger, réunira des spécialistes des différentes aires et en études de genre, chercheurs·ses confirmé·es et représentant·es de la jeune recherche, qui exploreront ensemble ces questions lors de trois tables rondes transversales.
2023 — 2024
Faire vivre et lire les revues
A l’occasion de l’exposition “Le Genre en revues” au Campus Condorcet, l’Institut du Genre et l’Humathèque organisent une table ronde donnant la parole aux lecteurs·rices, acteurs·rices de l’édition de revues scientifiques et professionnel·les de la documentation et de la diffusion. Que font les revues sur nos pratiques en études de genre – champ de recherche à la fois récent et en constante évolution ? Science ouverte et contraintes budgétaires, papier et/ou en ligne, traduits ou non, que choisir pour nos revues et collections ? Et comment être inclusif·ve·s dans un titre – de numéro ou d’article –, au fil des textes et au sein des collections documentaires ? Ce sont quelques-uns des thèmes qui seront proposés à la discussion. La séance est ouverte à toustes, sur inscription à l’adresse suivante : gis.genre@gmail.com.
- Intervenant·es :
- Pauline Augé, Chargée du fonds Histoire des femmes et études de genre – Humathèque Condorcet : Le fonds documentaire des études de genre à l’Humathèque.
- Sophie Astier, Responsable du service des collections documentaires – Humathèque Condorcet : La politique d’acquisition des revues à l’Humathèque.
- Camille Circlude, Auteurice de “La typographie post-binaire” et membre de Bye-Bye Binary (sous réserve).
- Sophie Decoux, Designer graphique indépendante, en charge de la direction artistique du Printemps des Humanités.
- Samantha Saïdi, Chargée de partenariat Recherche au CNRS (Persée UAR 3602).
Echange animé par Fabrice Virgili (Conseil Scientifique de l’Institut du Genre)
Design graphique et genre : la fabrique des caractères
La présentation de l’exposition “Le genre en revues” à l’Humathèque du Campus Condorcet, du 8 février au 15 mars 2024, sera ponctuée par deux tables rondes. À l’occasion de l’inauguration de l’exposition, un premier échange est prévu dans le cadre des “Jeudis du Genre” le 8 février 2024, de 17h à 18h30, à l’Humathèque. L’échange sera suivi d’un cocktail à l’occasion de l’inauguration de l’exposition. La séance est ouverte à toustes, sur inscription à l’adresse suivante : gis.genre@gmail.com.
Comment traduire des engagements féministes en design graphique, et quels sont les apports des pratiques féministes et queer du design graphique aux luttes contre les discriminations envers les minorités de genre ? Intitulée “Design graphique et genre : la fabrique des caractères”, cette discussion rassemblera Olivia Grandperrin et Camille Baudelaire, pour l’Atelier Baudelaire, studio de recherche et de création ; Eugénie Bidaut, graphiste et dessinatrice de caractères typographiques ; et sera modéré par Magali Nachtergael, professeure en littérature française (XXe – XXIe), théorie et arts visuels à l’université Bordeaux Montaigne.
Porté par Camille Baudelaire et Olivia Grandperrin, Atelier Baudelaire est un studio de recherche et de création spécialisé dans les domaines de la culture, des territoires et de la recherche, reliant le design graphique, l’espace et le volume. En parallèle de leurs projets de commandes pour des institutions telles que l’Institut du Genre, HF Auvergne Rhônes-Alpes ou Rennes Métropole, Camille et Olivia mènent depuis plusieurs années un travail de recherche engagé sur la construction des stéréotypes de genre chez les enfants, et sur la manière dont les marques construisent les identités genrées. Elles s’intéressent également au design des outils pédagogiques d’apprentissage de la lecture et de l’écriture par le biais de la typographie, et à l’évolution des écritures du Féminisme dans l’espace public.
Eugénie Bidaut est graphiste et dessinatrice de caractères typographiques, travaillant principalement pour et avec des structures culturelles et des organisations militantes. Son travail consiste en grande partie à mobiliser des savoir-faire typo·graphiques pour rendre visibles et lisibles des textes militants n’ayant souvent pas bénéficié d’une large diffusion. Depuis 2020, d’abord au sein de l’Atelier national de recherche typographique puis de la collective Bye Bye Binary, elle mène également une recherche pratique et théorique sur le dessin de caractères en tant qu’outil de démasculinisation et de débinarisation de la langue française et participe à la création de diverses fontes inclusives et post-binaires.
Remise du Prix de thèse 2023
La cérémonie de remise du Prix de thèse 2023 de l’Institut du Genre, par la philosophe Geneviève Fraisse, aura lieu le 25 janvier à 17h à la MSH Paris Nord. Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de heloise.humbert@mshparisnord.fr si vous souhaitez assister à la cérémonie.
Irène Gimenez et Florence Wenzek sont les deux lauréates. Irène Gimenez, pour sa thèse intitulée « Devenir prisonnier‧e politique. Une histoire sociale et genrée de la prison politique en fin et sortie de dictature, Espagne 1963-1987 » (histoire), rédigée sous la direction de Laurent Douzou et Mercedes Yusta Rodrigo ; et soutenue à l’Université Lyon 2. Florence Wenzek, pour sa thèse intitulée « La fabrique genrée de la nation tanzanienne. Éduquer et former les filles et les femmes (1939-1976) » (sciences de l’éducation et de la formation), réalisée sous la direction de Rebecca Rogers et Odile Goerg ; et soutenue à l’Université Paris Cité.

Le sujet de l’anorexie : genre et pouvoir
Titulaire de la Chaire Genre, Karine Tinat donnera une conférence dans le cadre des “Jeudi du Genre” le 10 novembre 2023 à l’Université Paris Nanterre (informations sur la salle à venir).
Résumé du sujet de l’intervention : “L’anorexie, comme trouble du comportement alimentaire, complexe et multifacétique, comporte des dimensions corporelles, sociales et relationnelles. Cette intervention présentera une réflexion à partir du concept de sujet et des rapports hiérarchiques de génération et de genre. Plus précisément, on questionnera la volonté de devenir sujet, la notion de contrôle et de domination dans les rapports au corps et à l’autre. La réflexion, fondée sur un travail de terrain à Mexico, exposera ses prismes théoriques et sa stratégie méthodologique.”

2022 — 2023
L’acculturation des études de genre en histoire du droit. Le défi de l’ANR HLJPGenre
Séance organisée par Prune Decoux et Hélène Duffuler-Vialle pour le projet ANR HLJPGenre. Prune Decoux est chercheuse en histoire du droit à l’Université d’Artois, membre du Centre Droit Ethique et Procédures (CDEP, EA 2471), membre associée de l’Institut de Recherche Montesquieu (IRM, EA 7434), et post-doctorante du projet ANR HLJPGenre. Hélène Duffuler-Vialle est maîtresse de conférences en histoire du droit à l’Université d’Artois, membre du Centre Droit Ethique et Procédures (CDEP, EA 2471), membre associée du Centre d’Histoire Judiciaire (CHJ, UMR 8025), membre de Criminocorpus (CLAMOR, UAR 3726), et coordinatrice du projet ANR HLJPGenre.
Si l’état d’acculturation des études de genre varie selon les disciplines de sciences humaines et sociales, l’histoire du droit – discipline universitaire du droit autonome à l’instar du droit public et du droit privé – en est au début de processus : à savoir une quête de légitimité, d’assise institutionnelle. Ceci d’une part afin d’éviter aux historien.nes du droit qui se sont saisi.es des études de genre d’être marginalisé.es et d’autre part de développer les recherches dans ce sens, à la fois dans l’intérêt d’un renouvellement des approches et des paradigmes en histoire du droit, mais également d’un enrichissement des études de genre par l’adjonction des travaux d’une nouvelle discipline, avec ses objets et méthodes scientifiques spécifiques. Dans ce contexte, le projet ANR HLJPGenre entend relever le défi, d’abord en identifiant puis en fédérant les pionnier.es des études de genre dans la discipline, en formant les chercheur.euses intéressé.es par celles-ci et en mettant en place un dialogue interdisciplinaire facilité par la connexité des disciplines : le droit positif, l’histoire et en particulier l’histoire de la justice, la sociologie et, notamment, la socio-histoire du droit.

Remise du Prix de Thèse 2022
La cérémonie de remise du prix aura lieu le 1er février 2023 . Le prix sera remis aux lauréatᐧes par Catherine Vidal, neurobiologiste, Directrice de recherche honoraire à l’Institut Pasteur de Paris.
Kévin Bideaux (pour sa thèse intitulée « La Vie en rose. Petite histoire d’une couleur aux prises avec le genre ») et Laure Sizaire (pour sa thèse intitulée « Des romances au-delà des frontières. La globalisation genrée du marché matrimonial : échanges intimes, expériences migratoires et réflexivités sur le genre dans les conjugalités franco-postsoviétiques (1990-2015) ») sont les deux lauréat·es du Prix de thèse 2022 de l’Institut du Genre.

Deprived at Both Ends: Women under Secular and Religious Family Law
Inscription obligatoire auprès de sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr avant le 7/12/22, 14h
Prof. Daphna Hacker is a legal scholar and a sociologist, currently (Aug. 2022-Jan. 2023) visiting Dickson Poon School of Law, King’s College. She is a full professor at the Law Faculty and the Women and Gender Studies Program, Tel Aviv University. Her socio-legal research focus on the intersection of law, families and gender and provides empirical as well as normative insights in relation to post-divorce parental arrangements, inheritance conflicts, filial piety towards elder parents, and transnational families.
“Israel is the only country in the world with a dual family law system, which includes State Family Courts and State Religious Courts. The law is also an amalgam of civil an religious components. Hence, as I will demonstrate, Israel is a relevant laboratory for jurisdictions faced with religious minorities’ demand for autonomy over family law matters, and the challenges such a demand poses for safeguarding gender equality. Notwithstanding, I will also demonstrate that recent activism on behalf of Israeli family court judges, in the name of gender formal equality, harms women. Indeed, for the first time in Israeli legal history, family law lawyers advise their female clients to turn to the religious court, rather than the family court, for child custody and child support. Hence, the Israeli case study demonstrates the urgent need for family law that strives for a world without gender, yet recognizes how deeply families are still gendered.”
Le Brésil et la santé mentale : les enjeux de genre, vulnérabilité et violence
Patricia Porchat, psychanalyste, professeure au Département de Psychologie de l’UNESP – Bauru, Brésil, et accueillie dans le cadre de la Chaire Genre 2022 par l’Université Paris-Cité, interviendra en dialogue avec Thamy Ayouch (professeur au Département d’Etudes Psychanalytiques à l’Université Paris Cité). La séance, ouverte à tousᐧtes, sera modérée par Beatriz Santos (maîtresse de Conférences – Département d’Etudes Psychanalytiques à l’Université Paris Cité).
Qu’est-ce qui détermine la vulnérabilité et la violence par rapport aux expressions identitaires divergentes du corps, de la sexualité et du genre ? Le Brésil est devenu un triste exemple de l’invisibilisation, du silence et de la mort de ceux et celles que l’on considère comme faisant partie d’une dissidence identitaire. Cette dissidence inclut le fait d’être une femme, une personne noire ou indigène, unᐧe homosexuelᐧle ou unᐧe transsexuelᐧle. Les recherches de Patricia Porchat Knudsen mettent en évidence les effets de la vulnérabilité et de la violence sur la santé mentale de cette population et proposent des interventions à partir de la psychanalyse.

2021 — 2022
Écriture inclusive et pronoms non-binaires : enjeux, perspectives et débats
Séance organisée autour de l’ouvrage : Devenir non-binaire en français contemporain, dirigé par Louisa Mackenzie & Vinay Swamy, parru en 2022 aux éditions Le Manuscrit. Intervenant⋅es : Maria Candea (professeure de linguistique à l’Université Sorbonne Nouvelle) ; Luca Greco (professeur de sciences du langage à l’Université de Lorraine) ; Vinay Swamy (professeur d’études françaises et francophones à Vassar College). Modération : Anne Isabelle François (CERC)
Résumé de l’ouvrage par l’éditeur : “Durant ces dernières années, la visibilité des personnes non-binaires qui revendiquent publiquement en anglais et en français leur identité au-delà du genre binaire s’est largement accrue. Alors que le singulier « they » a gagné la faveur de nombreuses personnes dans les espaces anglophones, les personnes francophones non-binaires ont dû faire face à d’autres défis concernant la langue et la syntaxe, étant donnée la nature binaire de la grammaire française elle-même. Ce volume collectif examine les tentatives récentes visant à mettre à la disposition de tout le monde une langue et des identités équitables, inclusives et expansives au sein des espaces linguistiques, culturels et pédagogiques francophones. De ce fait, Devenir non-binaire en français contemporain conteste l’idée reçue du genre non-conforme comme simple importation d’outre-Atlantique, d’un modèle identitaire à la base américaine.”

La question du genre : populisme, reproduction nationale et crise de la représentation
Conférence plénière de Camille Robcis (Columbia University), titulaire de la Chaire internationale printemps 2022 de l’Institut du Genre, organisée avec Juliette Rennes (EHESS) et Mathieu Trachman (INED). Camille Robcis est accueillie par l’École Universitaire de Recherche « Gender & Sexuality Studies » (EUR GSST, EHESS/Ined).
Comment et pourquoi l’idée d’une « théorie du genre » s’est-elle répandue à travers le monde depuis les années 1990 ? Beaucoup plus invoquée qu’expliquée, la « théorie du genre » est souvent présentée par ses opposants à la fois comme l’origine et la conséquence inévitable de lois visant à promouvoir l’égalité des droits des femmes et des LGBT+. L’intervention sera centrée sur le cas des manifestations contre « le mariage pour tous » en France et plus particulièrement sur le problème de la représentation politique lors de ces débats.
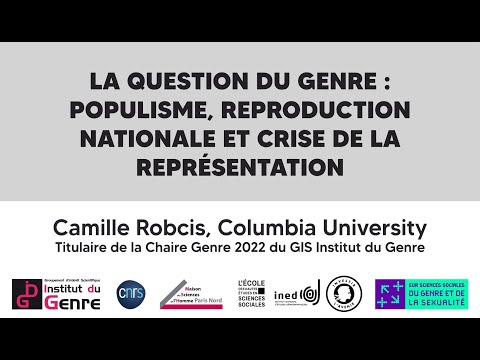
Reflections on Gender Studies in Nigeria : issues, perspectives and debates
Session organized with IFRA – French Institute for Research in Africa.
Speakers : Mutiat Oladejo (Department of History, University of Ibadan), Adebayo Adedeji (Department of Peace and Studies, University of Ibadan), Sharon Omotoso (Coordinator of Women’s Research and Documentation Center, Institute of African Studies, University of Ibadan), Seun Olutayo (Chair, director of Gender Studies Programme, University of Ibadan)
Moderators : Anne Hugon (IMAF) et Sara Panata (CHS and IFRA)
Des Maliennes en résistance : écrits et musiques
Avec Cheryl Toman, Professeure à l’Université d’Alabama, titulaire de la Chaire Genre 2021 de l’Institut du Genre, en accueil au CIELAM et Catherine Atlan (IMAf), spécialiste d’histoire de l’Afrique. Modération : Susanne Böhmisch (Echanges) et Catherine Mazauric (CIELAM)
“Impossible de connaître la littérature et la musique maliennes sans les contributions des femmes. Leurs textes et chansons dénoncent toutes formes de violences faites aux femmes tout en soulignant qu’hommes et femmes vivent différemment les conflits et les violences associées. Avec un “répertoire anti-guerre et anti-violence” pour unir tous les Maliens, ces créatrices transmettent un message fort en soutien aux victimes de violences sexuelles, défendent les droits des femmes, critiquent leur société, réclament de véritables changements.”

Remise du prix de thèse 2021
Le Prix de thèse 2021 a été remis aux lauréates par Mme Michèle Le Doeuff, philosophe, ancienne professeure ordinaire à l’Université de Genève et directrice de recherche au CNRS, le 24 novembre 2021 à 18h en salle du conseil de l’Hôtel à projets du Campus Condorcet.
Elsa BOULET : « Espaces et temps de la « production d’enfants ». Sociologie des grossesses ordinaires », en sociologie, sous la direction de Christine Détrez et Marc Bessin, soutenue le 18 juin 2020 à l’Université Lyon 2 Lumière.
Florys CASTAN-VICENTE : « Un corps à soi ? Activités physiques et féminismes durant la « première vague » (France, fin du XIXe siècle – fin des années 1930) », en histoire, sous la direction de Pascal Ory, soutenue le 23 novembre 2020 à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1.

2020 — 2021
La recherche médicale au prisme du genre
Jeudi du Genre et journée d’étude Gesci.
Laurence Huc, toxicologue en santé humaine (Inra Toxalim) : “Influence du genre dans la fabrique de la science : le cas des perturbateurs endocriniens”
Julie Jarty, sociologue (Université Toulouse Jean Jaurès, CERTOP) : “Les ‘1000 jours’ ou l’héritage maternel jusque dans les gènes : généalogie sexuelle d’un programme de biosciences”
Odile Fillod, chercheuse indépendante, auteur du blog Allodoxia : “Une médecine inadaptée aux femmes car négligeant le sexe en tant que variable biologique ?”
Lucile Ruault (CR CNRS au Cermes3) : “Faire de l’avortement ‘un acte médical comme un autre’ : les enjeux croisés de spécialisation et de genre dans la lutte pour l’avortement libre”
Remise du Prix de thèse 2020
Le Prix de thèse 2020 a été remis aux lauréates par Michèle FERRAND, sociologue, le 14 janvier 2021, au Campus Condorcet. La vidéo de la cérémonie sera prochainement mise en ligne.
Rocío MUNGUÍA AGUILAR : « Encres métisses, voix marronnes : mémoires d’esclaves noires dans le roman antillais francophone et le roman latino-américain hispanophone, Littératures française et francophone », sous la direction d’Anthony Mangeon (Université de Strasbourg), soutenue le 21 septembre 2019 à l’Université de Strasbourg.
Michal RAZ : « La production des évidences sur l’intersexuation. Savoirs et pratiques médicales autour de l’hyperplasie congénitale des surrénales » (France, 1950-2018) sous la direction d’Ilana Löwy (INSERM), soutenue le 27 septembre 2019 à l’EHESS.

2019 — 2020
La construction de l’égalité des sexes et des sexualités à l’épreuve de l’école
Gaël Pasquier (UPEC), Sophie Richardot (UPJV), Virginie Descoutures (UPJV).
Autour de l’ouvrage Construire l’égalité des sexes et des sexualités. Pratiques enseignantes à l’école primaire, Gaël Pasquier, Presses Universitaires de Rennes, 2019 : “Ce livre présente les pratiques des professeurs et des professeuses des écoles (maternelle, élémentaire) qui se saisissent de la question de l’égalité des sexes et des sexualités. Loin des polémiques, il vise à mieux cerner la spécificité de leur travail mais aussi la possibilité et les caractéristiques d’une éducation à l’égalité des sexes et des sexualités dès le premier degré d’enseignement, qui entendrait questionner aussi bien les savoirs scolaires que certains aspects du fonctionnement de l’école et de la classe au quotidien.”
Remise du Prix de thèse 2019
Les prix ont été remis par Rose-Marie Lagrave, sociologue, directrice d’études à l’EHESS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS).
Anaïs GARCIA pour « Ligatures – La reproduction des femmes indigènes au Guatemala, entre contrôle et résistances », anthropologie sociale et historique, sous la direction de Stéphanie Mulot et Valérie Robin Azevedo, soutenue le 23 novembre 2018 à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès (en ligne sur HAL). En 2019, elle est rattachée au Centre d’anthropologie sociale du Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (Toulouse 2, CNRS, EHESS).
Mona GÉRARDIN-LAVERGE pour « Le langage est un lieu de lutte. La performativité du langage ordinaire dans la construction du genre et les luttes féministes », philosophie, sous la direction de Sandra Laugier, soutenue le 14 décembre 2018 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (en ligne). En 2019, elle est post-doctorante à l’Université Paris Lumières, laboratoire Sophiapol (Université Paris Nanterre) et chercheure associée à l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne (Université Paris 1).
